
En octobre 2021, Richard Lynn publiait chez Arktos Sex Differences in Intelligence (Les différences sexuelles dans l’intelligence). Nous en présentons ici une synthèse agrémentée de quelques commentaires qui approfondissent ou illustrent les propos de l’auteur. La thèse de l’ouvrage est que les hommes ont un QI (quotient intellectuel) moyen supérieur de quatre points à celui des femmes. Si cela n’avait pas été remarqué avant Richard Lynn, c’est parce que cet avantage cognitif ne se dessine qu’à partir de la fin de l’adolescence, quand le cerveau des garçons continue de grossir, là où celui des filles connaît déjà sa taille définitive : c’est la théorie développementale.
L’intuition du XIXe siècle
« Ce qui établit la distinction principale dans la puissance intellectuelle des deux sexes, c’est que l’homme atteint, dans tout ce qu’il entreprend, un point auquel la femme ne peut arriver, quelle que soit, d’ailleurs, la nature de l’entreprise, qu’elle exige ou une pensée profonde, la raison, l’imagination, ou simplement l’emploi des sens et des mains. […] Nous pouvons ainsi déduire de la loi de la déviation des moyennes, si bien expliquée par M. Galton dans son livre sur le Génie héréditaire, que si les hommes ont une supériorité décidée sur les femmes en beaucoup de points, la moyenne de la puissance mentale chez l’homme doit excéder celle de la femme[1]. » Voici ce qu’écrivait Darwin dans The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (La Filiation de l’homme et la sélection liée au sexe). Darwin et les grands biologistes du XIXe siècle, comme Broca ou Romanes, avaient constaté la supériorité intellectuelle des hommes sur les femmes et l’expliquaient par des différences de forme ou de taille et de poids du cerveau[2].
Même QI, mais cerveaux de taille différente : paradoxe ?
Au XXe siècle, l’invention des « tests » (analyses en français) d’intelligence permet de comparer avec précision l’intelligence des deux sexes. Or, à la grande surprise des chercheurs, les différences moyennes qui apparaissent çà et là sont négligeables. D’Edward Thorndike à Arthur Jensen, en passant par Lewis Terman, Cyril Burt et Raymond Cattell, tous des grands noms de la psychométrie, personne ne constate un réel avantage masculin.
En dépit de ce consensus, le problème posé par Broca, Darwin et Romanes tient toujours : l’association entre l’intelligence et la taille du cerveau devrait donner aux hommes, parce qu’ils ont en moyenne un cerveau plus gros, une intelligence supérieure.
On sait depuis 1888, grâce aux mesures que Francis Galton a faites auprès des étudiants de Cambridge que la taille du cerveau est liée à l’intelligence. Précisément, analysées par Pearson, les données de Galton permettent de dégager une corrélation de 0,11. Par la suite, de nombreuses études, plus précises, ont retrouvé une corrélation positive et cette fois-ci bien plus importante : l’imagerie par résonance magnétique, en donnant une estimation quasi parfaite de la taille du cerveau, donne des corrélations avec le QI allant de 0,3 à 0,4[3].
Taille absolue et taille relative du cerveau
Toujours dans La Filiation de l’Homme, Darwin demande : « Le cerveau de l’homme est, absolument parlant, plus grand que celui de la femme ; mais est-il plus grand relativement aux dimensions plus considérables de son corps ? ». C’est certain, la différence de taille du cerveau selon le sexe est bien documentée depuis les travaux fondateurs de Paul Broca. Une méta-analyse de 77 études, publiée en 2014, conclut que les hommes ont un volume cérébral supérieur de 12 % à celui des femmes.[4] Mais qu’en est-il de la taille relative ? C’est une remarque essentielle de Darwin parce que la taille relative du cerveau est un bien meilleur indicateur de l’intelligence que la taille absolue. Dans les années 1970 et 1980, l’idée que la taille relative du cerveau était la même entre les sexes commençait à s’installer, mais elle a été formellement contestée en 1992 par un biologiste, Davison Ankney[5]. Il écrit[6] : « La grave erreur méthodologique consistait à utiliser le rapport entre la masse du cerveau et la taille du corps à la place d’une analyse de la covariance […]. [Je] l’ai illustré en montrant que, tant chez les hommes que les femmes, le rapport entre la masse cérébrale et la taille du corps diminue quand celle-ci augmente. Aussi […] les femmes les plus grosses ont un rapport plus petit que les femmes les plus fines, et il en va de même pour les hommes. Donc, parce que l’homme moyen est plus volumineux que la femme moyenne, le rapport de la masse du cerveau avec la taille du corps est le même. En conséquence, la seule comparaison sensée est celle du rapport entre la masse du cerveau et la taille du corps d’hommes et de femmes de même taille. De telles comparaisons montrent qu’à n’importe quelle taille, le rapport entre la masse cérébrale et la taille du corps est bien plus haut chez les hommes que chez les femmes (figure 2). En contrôlant la taille du corps, les hommes ont donc toujours un cerveau plus gros et lourd que celui des femmes, d’à peu près 100 g [contre 140 g en valeur absolue, NDLA]. »

En 1992, Ankney restait perplexe. Les données psychométriques ne semblaient pas donner une intelligence moyenne supérieure aux hommes, aussi proposa-t-il quatre solutions au paradoxe : 1. Le poids, la taille et la surface du corps ne tiennent pas compte d’éventuelles différences sexuelles quant à tel ou tel effort somatique qui justifierait un cerveau plus gros ; 2. les analyses de QI favorisent les femmes ; 3. le cerveau des femmes est plus efficace que celui des hommes ; 4. la taille relative du cerveau plus élevée des hommes est liée aux domaines cognitifs pour lesquels ils excellent, comme l’intelligence spatiale. Si Ankney préfère cette dernière hypothèse, il n’a rien pour l’étayer.
Pour résoudre ce paradoxe, Arthur Jensen a émis l’idée que les femmes avaient le même nombre de neurones que les hommes, mais étaient mieux agencés. C’est la troisième solution proposée par Ankney, et elle s’est révélée fausse en 1997 après que l’on eut découvert que les femmes avaient quatre milliards de neurones néocorticaux de moins que les hommes (19,3 milliards contre 22,8 milliards, une différence de presque 16 %). L’étude montre que l’âge et le sexe sont les deux principales variables qui expliquent cette différence neuronale, sans que la taille ne l’influence[7].
Les analyses de QI favorisent-elles les femmes ?
Si Ankney balaie l’hypothèse d’analyses biaisées à l’avantage des femmes, Richard Lynn la prend au sérieux. Il cite Joseph Matarazzo : « Dès le début, ceux qui ont développé les analyses d’intelligence les plus connus (Binet, Terman et Wechsler) ont bien fait attention à contrebalancer ou éliminer de leur échelle finale toutes les sous-analyses ou les items qui, empiriquement, donnaient un résultat plus élevé à un sexe ou à l’autre. » Il cite aussi Kaufman et Lichtenberger selon lesquels « les développeurs des analyses ont régulièrement essayé d’éviter les biais sexuels durant les phases de développement. » Précisément, les analyses de Wechsler ont été purgées des épreuves de perception spatiale, de rotation mentale et d’intelligence mécanique sur lesquelles les hommes avaient respectivement un avantage de 9.6, 10.9 et 10.2 points[8].
Est-ce là la résolution du paradoxe ? Non, ou pas seulement, car malgré les tentatives des constructeurs des analyses d’égaliser les résultats entre les sexes, une différence moyenne persiste.
La résolution du paradoxe
À partir des années 1990, Richard Lynn publie une série d’articles dans lesquels il expose la théorie développementale[9]. Il y montre que les garçons et les filles ont le même QI jusqu’à l’âge de 15 ans, et qu’à partir de 16 ans, un écart se creuse jusqu’à l’âge adulte et atteint environ 4 points. Ce qui explique cette différence est qu’à 16 ans, le cerveau des garçons continue de grandir, ce qui a été confirmé par des études neurologiques qui montrent que chez les garçons, au milieu de l’adolescence, la matière blanche grossit plus que chez les femmes. Cette thèse va dans le sens de toute la littérature scientifique qui montre que les garçons finissent leur croissance plus tard et ont une maturation cérébrale et comportementale plus tardive que les filles.
Les données les plus récentes sont compilées dans Sex Differences in Intelligence, ouvrage que Richard Lynn a publié chez Arktos en 2021. Dans un chapitre qui sert d’introduction à la théorie développementale, il présente dans un tableau reproduit ci-après les études qui comparent l’évolution de la taille du cerveau suivant l’âge et le sexe ; elles montrent qu’à partir de 16 ans, un avantage masculin se creuse jusqu’à 21 ans. Les analyses psychométriques suivent la même tendance. Réalisés aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne, elles montrent que c’est entre 14 et 16 ans que l’avantage cognitif des garçons se dessine. La première ligne du tableau est la capacité crânienne des femmes donnée en pourcentage par rapport à celle des hommes. On note qu’elle décline à partir de quinze ans. La deuxième ligne expose les différences sexuelles dans la taille du cerveau en cm3. Les lignes suivantes montrent les différences de performance selon le sexe sur différentes analyses de l’intelligence. Quand la taille d’effet[10] donnée est positive, les garçons ont de meilleurs résultats.

Le chapitre suivant est consacré aux enfants et montre que jusqu’à quatre ou cinq ans les filles sont plus intelligentes que les garçons. Le chapitre quatre porte sur les matrices de Raven, qui sont l’une des meilleures mesures de l’intelligence. Lynn y présente plusieurs méta-analyses, à jour en 2021, qui donnent tort à ceux qui prétendent que les matrices ne montrent pas d’avantage masculin, ou un avantage négligeable. Systématiquement, quand les données sont analysées en fonction de l’âge, les garçons dévoilent un avantage substantiel à la fin de l’adolescence, et cela même quand les matrices n’analysent pas l’intelligence visuo-spatiale. Le chapitre cinq porte sur les analyses de Wechsler. Elles sont largement utilisées, car elles englobent un échantillon important de capacités cognitives. Le WPPSI (4 à 6 ans) ne montre pas d’avantage masculin ; le WISC (6 à 16 ans) montre un léger avantage masculin (1,8 point) ; le WAIS, pour les adultes, montre un avantage de 3.6 points, pas loin des 4 estimés par Lynn dans son premier article de 1994. Le chapitre six se concentre sur les autres analyses de l’intelligence, principalement des épreuves spécifiquement nationales, qui donnent en moyenne un avantage masculin de 3,45 points. Le chapitre sept s’intéresse au temps de réaction, dont la corrélation avec le QI oscille de 0,30 à 0,56 selon les études. L’avantage masculin touche tant au temps de réaction visuel qu’auditif, et selon une méta-analyse récente, sa taille d’effet est de 0,35 d. Avec une corrélation de 0,30 entre le QI et le temps de réaction, cela donne un avantage masculin de 2,1 points de QI. Le chapitre 8 se penche précisément sur g, c’est-à-dire l’intelligence générale. Dans une analyse de QI, les résultats des différentes tâches sont positivement corrélés, et il en ressort ce facteur g, qui explique généralement autour de 50 % de la variance totale. g est ce que les analyses de QI mesurent de plus important, parce que plus g est élevé, et plus les tâches complexes rencontrées au travail et dans la vie quotidienne sont faciles[11]. Cependant, il n’est pas évident d’extraire g des analyses psychométriques pour comparer les performances de deux groupes. Lynn retrace les controverses statistiques autour des différences sexuelles quant à g et note, après qu’une méthode optimale a été élaborée, qu’au moins 2,4 des points qui donnent l’avantage aux hommes sont attribuables à g.
Hypothèses évolutionnaires
Dans le chapitre neuf, Richard Lynn propose l’idée selon laquelle la domination intellectuelle des hommes vient de la compétition pour le territoire et le statut social, qui permet l’accès aux femmes et à la reproduction. Nos ancêtres masculins les plus intelligents auraient pu « conclure des alliances plus efficaces, montrer leur qualité de chef à la chasse comme à la guerre et dominer les hommes les moins intelligents ». Selon Lynn, il se trouve là l’explication à la maturation plus tardive du cerveau des garçons. Ceux-ci ont besoin d’acquérir des compétences et de l’expérience dont les femmes n’ont pas besoin.
Une deuxième hypothèse vient de la sélection sexuelle, parce que les femmes préfèreraient les hommes plus intelligents. Il n’est pas évident que l’intelligence soit directement choisie par les femmes – et il est même notable que les femmes ne sont pas attirées par les hauts niveaux d’intelligence[12]. Par contre, elles le sont par le statut social, qui est substantiellement corrélé à l’intelligence.
Lynn note des différences raciales quant à la magnitude des différences sexuelles dans l’intelligence. Chez les congoïdes, l’écart entre les sexes est inférieur à celui constaté chez les caucasoïdes européens. Cela est concordant avec le fait, mis au jour par Rushton, que la différence de taille du cerveau entre les sexes est plus importante chez les caucasoïdes européens (204 cm3) que chez les congoïdes américains (189 cm3) – pour les officiers, car les données viennent de l’armée américaine, l’écart entre les sexes passe de 210 cm3 pour les caucasoïdes à 197 cm3 pour les congoïdes. Selon Lynn, l’explication évolutionnaire la plus probable est que les défis cognitifs ont été plus difficiles dans l’environnement évolutionnaire des caucasoïdes, notamment en raison des hivers froids. Il note l’existence de données qui confirment son hypothèse : les différences sexuelles dans les « compétence de chasse » sont plus marquées chez les caucasoïdes américains que chez les congoïdes américains.
Enfin, si Richard Lynn a raison, l’écart cognitif entre les sexes devrait être plus grand chez les mongoloïdes du Nord-Est, qui ont subi un environnement encore plus difficile et donc cognitivement demandeur. Or, les résultats des différentes analyses de Wechsler montrent une taille d’effet moyenne de 0,31 d pour différences sexuelles entre les mongoloïdes du Nord-Est contre 0,21 d pour les caucasoïdes européens.
Avantages masculins et avantages féminins
Les chapitres 10 et 11 consistent à montrer que les hommes et les femmes ont des points forts respectifs dans des domaines cognitifs spécifiques. Où les hommes sont-ils meilleurs ? Dans le raisonnement non verbal et abstrait, le raisonnement verbal (similitudes et compréhension), l’intelligence numérique et mathématique, l’arithmétique mentale, l’arithmétique écrite, l’intelligence spatiale, le raisonnement mécanique et la culture générale. Où les femmes sont-elles meilleures ? Dans la fluidité verbale, la capacité d’apprentissage d’une seconde langue, la mémoire visuelle et la mémoire de l’emplacement des choses, la capacité d’épeler, la vitesse de perception et de traitement, la capacité de lecture, la mémoire épisodique, la capacité d’écriture, la dextérité, la mémoire immédiate (sauf quand elle est mesurée par le WISC et le WAIS…) et la théorie de l’esprit, c’est-à-dire comprendre ce que les autres pensent – les femmes décodent en effet mieux les indices non verbaux et identifient mieux les émotions que les hommes. Lynn note un avantage féminin important (0,47 d) pour l’intelligence émotionnelle, mais celle-ci, croyons-nous, n’est que l’association de l’intelligence générale avec des traits désirables du modèle en cinq grands traits[13] – où, il est vrai, les femmes ont un avantage quant à la conscienciosité, l’agréabilité et certaines facettes de l’extraversion[14].
Et la plus grande variabilité des hommes ?
Dans son dernier ouvrage, Richard Lynn ne fait pas grand cas de l’hypothèse selon laquelle les hommes feraient montre d’une plus grande variabilité quant à l’intelligence. L’une des raisons à cela, probablement, est qu’une méta-analyse qu’il a conduite avec Paul Irwing en 2005[15] ne trouvait pas de plus grande variabilité masculine dans les résultats aux matrices de Raven – c’est même l’inverse qui a été trouvée, les femmes étaient plus variables ! Cependant, il conclut son étude en précisant que l’hypothèse est peut-être juste et qu’il n’a pas été en mesure de la vérifier, car ses données, récoltées à l’université, excluent les attardés mentaux. Ceux-ci sont-ils surreprésentés parmi les hommes ? Les données sont insuffisantes pour en être en certain, dit Lynn.
En réalité, la plus grande variabilité phénotypique des hommes, notamment sur le plan intellectuel, fait l’objet d’une littérature non négligeable. Edward Dutton, qui travaille régulièrement avec Richard Lynn, s’étonne d’ailleurs de l’absence d’un chapitre consacré à la question[16]. Pourquoi les hommes seraient-ils plus variables biologiquement ? Ce serait une affaire de chromosome X, qui, relativement au chromosome Y, contient beaucoup d’information génétique, notamment sur le développement cérébral. Si les hommes n’ont qu’un chromosome X, les femmes en ont deux. Aussi expriment-elles, quand elles sont hétérozygotes, une version intermédiaire de tel ou tel trait[17]. Cela dit, le chromosome X n’est peut-être pas le seul responsable. Peut-être que l’avantage moyen et la plus grande variabilité des hommes sont toutes les deux dues à la façon dont les hormones androgènes changent l’expression des gènes. La testostérone semble être la cause de l’avantage des hommes dans l’intelligence spatiale, par exemple ; et si la testostérone exacerbe l’expression des gènes de l’intelligence, qu’ils soient bénéfiques ou délétères, il y a là une explication de la plus grande variabilité masculine[18].
Conclusion
Pas assez cosmopolitiquement correcte, la thèse de Richard Lynn est largement ignorée par ses pairs. Pourtant, dès 1994, Richard Lynn avait apporté des données et une réflexion convaincantes sur l’avantage moyen de quatre points qu’ont les hommes sur les femmes aux analyses de QI. Les données psychométriques du monde entier dessinent en effet ce même schéma, celui d’un avantage masculin qui apparaît clairement à la fin de l’adolescence et qui suit de près le développement physiologique et anatomique des garçons, notamment celui du la taille du cerveau. Sex Differences in Intelligence ne fait qu’enfoncer le clou.
Pierre de Tiremont
[1] https://fr.wikisource.org/wiki/La_Descendance_de_l’homme_et_la_sélection_sexuelle/19.
[2] Sex Differences in Intelligence, Arktos, 2021, p. 2.
[3] Ibid., p. 6. Richard Lynn ne précise cependant pas que la corrélation de 0.11 n’a pas été donnée par Galton, mais par Pearson.
[4] Ibid., p. 6.
[5] Ankney, C. Davison, « Sex differences in relative brain size: The mismeasure of woman, too? », Intelligence, 1992. Cité par Richard Lynn.
[6] J. Philippe Rushton, C. Davinson Ankney, « Whole Brain Size and General Mental Ability: A Review », International Journal of Neuroscience, 2009.
[7] Richard Lynn, op. cit., p. 7.
[8] Ibid., p. 40.
[9] Ibid., p. 9.
[10] « En statistique, une taille d’effet est une mesure de la force de l’effet observé d’une variable sur une autre […]. [L]e d de Cohen ou d’ permet de caractériser la magnitude d’un effet associé dans une population donnée par rapport à une hypothèse nulle. Traditionnellement, un d autour de 0.2 est décrit comme un effet « faible », 0.5 « moyen » et 0.8 comme « fort » […]. » Voir la page Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Taille_d%27effet.
[11] Linda S. Gottfredon, « Why g Matters: The Complexity of Everyday Life », Intelligence, 1997.
[12] Matthew A. Sarraf, Michael A. Woodley of Menie, Colin Feltham, Modernity and Cultural Decline, Palgrave, 2019, p. 283.
[13] Le modèle OCEAN (ouverture, conscienciosité, extraversion, agréabilité, neuroticisme), connu en anglais sous le nom de Big Five, décrit la personnalité en cinq traits principaux. Voir la page Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Modèle_des_Big_Five_(psychologie).
[14] https://www.inc.com/quora/its-time-to-stop-talking-about-eq-because-it-doesnt-actually-exist.html.
[15] Paul Irwing, Richard Lynn, « Sex differences in means and variability on the Progressive Matricesin university students: a meta-analysis », British Journal of Psychology, 2005.
[16] http://www.quarterly-review.org/the-case-for-greater-male-intelligence/.
[17] La désactivation, chez la femme, de l’un des deux chromosomes X ne rend pas cette hypothèse caduque, même si elle pousse à ne pas exagérer l’ampleur des différences sexuelles dans la variabilité. En effet, une part substantielle des gènes du chromosome désactivé s’échappent et s’expriment tout de même. Voir, sur cette question, ces deux articles :
Wendy Johnson, Andrew Carothers, Ian J. Deary, « A Role for the X Chromosome in Sex Differences in Variability in General Intelligence? », Perspectives on Psychological Science, 2009
Ian W. Craig, Claire M.A. Haworth, and Robert Plomin, « Commentary on ‘‘A Role for the X Chromosome in Sex Differences in Variability in General Intelligence?’’ (Johnsonet al., 2009) », Perspectives on Psychological Science, 2009.
[18] Davide Piffer, « Sex Differences in Intelligence: A Genetics Perspective », Mankind Quarterly, 2017.
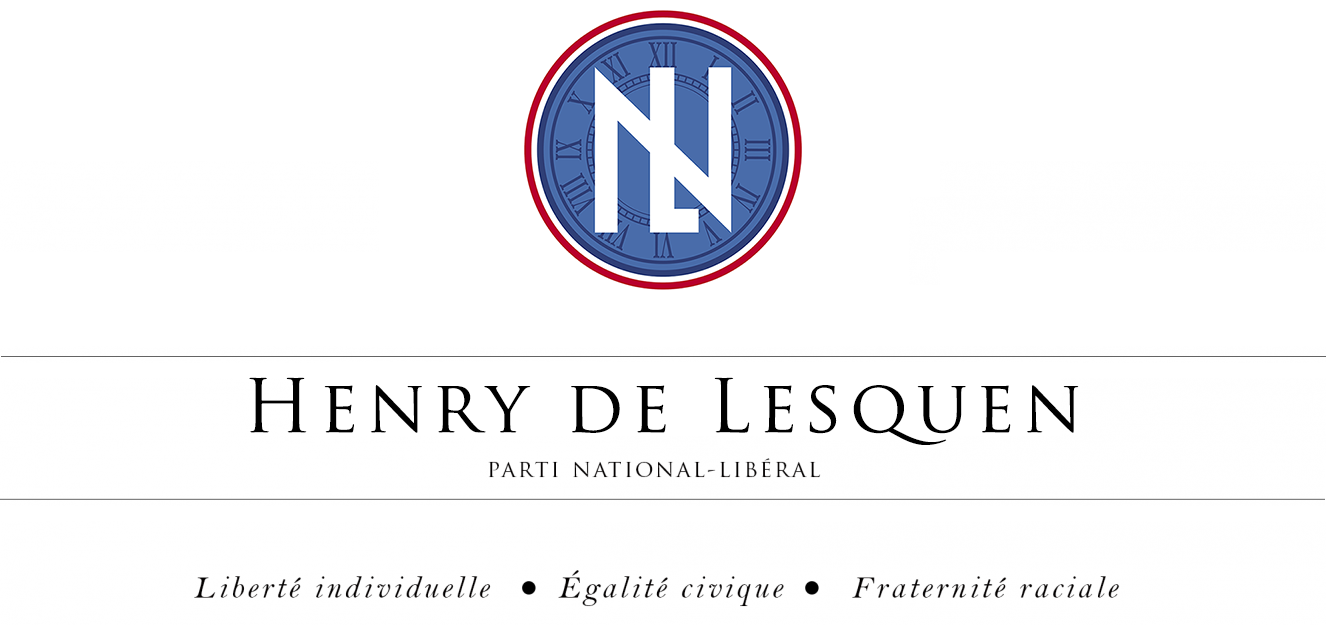





Ert
Génial !
Une minute de silence pour Richard Lynn
Lire « Une introduction empirique a la jeunesse » il demonstre que le cervau adolescent est a farse